Le
Commentaire : autre corrigé sur le net 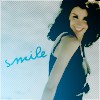
Il s'agit ici
d'illustrer le désespoir et la ruse d'un ami jaloux. Qui
se trouve en rivalité amoureuse avec une biche. Ce
pourrait tout ausi bien être avec une femme. Est moquée
notre capacité à supposer des sentiments et des
comportements humains aux animaux. Ici la gazelle n'est
pas exemplaire comme elle pourrait l'être dans ine
fable, elle n'est qu'un instrument pour tester la
qualité de l'amitié du sultan.
C'est aussi un
drame, car il s'en faut de peu ( l'intervention de
l'intendant) que le sultan pardonne à Osman et rende
confiance à ce dernier en l'amitié du Sultan et donc
dans l'humanité. Au lieu de cela, Osman ne cherchera
plus que l'indifférence de la nature loin des hommes et
des villes.
L'attention du
lecteur et tout d'abord sollicitée par la désignation
de l'un des protagonistes : "Le Sultan Yaya",
ce qui nous projette dans l'univers du conte, même si
aucun événement merveilleux n'intervient au cours du
récit. Le sultan est un personnage essentiel des contes
orientaux. L'auteur n'est pas oriental, puisqu'il a vécu
et est mort en France, mais il a vécu en orient et s'est
même fait nommer Abd el Haï (esclave de la vie) et
s'est converti à l'Islam.
Pas de
merveilleux, mais la gazelle est "merveilleusement
apprivoisée", "on s'attendait à chaque
instant au miracle
de la parole", nous voilà donc dans une parodie de
fable ou de conte de fées.
L'ironie
du narrateur se fait aussitôt sentir : il
démolit l'illusion de merveilleux,
et nous repousse dans la banalité
: "C'était cependant une gazelle très
commune", et l'inscrit dans la
réalité en précisant le lieu
géographique, ce qui ne se fait pas
beaucoup dans les contes : "née dans la solitude
des hauts plateaux du Yémen
(voir le titre, c'est le Yémen qu'on nomme
"l'Arabie heureuse").
Ainsi, la gazelle
n'est pas merveilleuse en elle-même, c'est l'amour
irraisonné que lui porte le sultan qui la transfigure
ainsi. Le sultan vit dans l'illusion. Comme le lecteur
emporté par le conte. La narration est une sorte de
gazelle aux yeux profonds. L'insistance sur le regard
"limpide et doux" suggère d'ailleurs un
pouvoir hypnotique qui pourrait nous faire penser au
serpent, symboliquement moins innocent et réellement
plus dangereux que la gazelle.
On retrouve
ensuite la tentation du merveilleux dans des expressions
comme "portée semble-t-il par des invisibles
ailes", tempérée par le doute :
"semble-t-il", c'est l'apparence, celle que
donne notre imagination à la réalité qui est ici
dénoncée. Dénoncée aussi par la crauté, ou le
réalisme : "à la place du chevreau qu'on avait
fait rôtir".
Le troisième
paragraphe souligne l'influence bénéfique de la gazelle
sur le décisions de justice du sultan, mais illustre en
même temps la fragilité de ces jugements : ils
dépendent de l'humeur du sultan, ce n'est donc pas la
justice.
L'erreur du
Sultan, là où il se révèle coupable, c'est
d'introduire un animal dans le monde des hommes, chacun
doit rester à sa place "comme
si réellement elle avait appartenu au monde des hommes".
Et cet aspect
extraordinaire de la gazelle se trouve à nouveau nié
dans le paragraphe qui suit : "En
cela elle ne différait pas des autres gazelles".
Cette gazelle, extraordinaire pour le sultan, est
dénoncée comme tout à fait ordinaire par le narrateur.
À nouveau
l'imagination est mise en accusation : "aussi
imagine-t-il tout ce qui plaît à son coeur et met-il en
ses pauvres bêtes si simples une âme pareille à la
sienne", c'est bien la
naïveté de l'antropomorphisme dont il est question ici.
L'introduction
proprement dite est à présent terminée. La situation
initiale est posée. Intervient l'élément
perturbateur : la jalousie
de l'ami d'enfance Osman. Car Osman
vit dans une nostalgie, celle de la pureté, de
l'innocence, de la gratuité des amités enfantines. Le
monde des adultes, avec ses calculs, ses compromissions,
ses hypocrisies, ses infidélités, ses querelles de
pouvoir le révulse à tel point qu'il partira vivre dans
un désert comme Alceste, le Misanthrope de Molière en a
le projet à la fin de la pièce.
"cette
bête, vraiment, tenait-elle au coeur de son ami autant
que lui-même". Osman est
fâché de se trouver mis en rivalité avec un animal :
"cette bête".
Se trouve posée
également la problématique
du conte, ou de la fable : une bête peut-elle, doit-elle
être mise en rivalité avec un homme ? Le reste de
l'histoire sera l'occasion d'une mise à lépreuve de
cette idée, en même temps qu'une mise à l'épreuve de
l'amitié du Sultan.
La première
réponse est apportée à Osman par son père défunt : "Ne
sois jamais le familier d'un sultan, car son amitié est
vaine...". C'est donc à la
vérification de la sagesse, de la véracité des paroles
de son père que va se livrer Osman. Son père lui a dit
également qu'on ne pouvait confier un secret à une
femme. La vérification est donc double. Et le père a
ici nécessairement raison, c'est dans l'ordre des
choses, dans les lois de la civilisation patriarcale :
l'ancien détient la sagesse, la connaissance, la
vérité, il connaît le monde, il en a fait
l'expérience.
C'est aussi dire
que les amités d'enfance ne peuvent résister aux
bouleversements que provoque l'entrée dans le monde des
adultes, dans la complexité des relations et des
hiérarchies sociales.
Un instant, Osman
se voit à la place du sultan : "Il
caressait doucement la gazelle",
mais c'est peut-être aussi par distraction, ou pour se
mettre dans les pensées de son ami quel effet cela
fait-il de caresser cette gazelle. On a vu le caractère
irraisonné de l'amour du sultan pour la gazelle, on
assiste à présent au geste irraisonné d'Osman "Brusquement,
cédant à une impulsion, d'un geste peut-être
involontaire".
C'est d'un
enlèvement qu'il s'agit, Osman enlève la bien-aimée du
sultan. Le caractère précipité des gestes étant
souligné par la succession des trois passés simples : "il
la saisit, l'enveloppa dans son manteau et
s'enfuit", ainsi que par
l'utilisation de l'adverbe : "brusquement".
Le récit est
lancé, le suspense commence : que va faire Osman de la
gazelle du sultan ? Que va-t-il lui arriver ? Sera-t-il
pris ? Sera-t-il condamné ? Quel sentiment triomphera
chez le sultan, de l'amitié ancienne ou de cette passion
pour une gazelle ?
|