
La moindre question ou difficulté ?
ÉCRIT
Définition
de l'épreuve écrite, le texte officiel 
Modèles
de sujets d'écrit sur le roman 
Préparation à la
dissertation : 
Lexique
des termes littéraires 
exercice
portant sur les figures de style 
Déroulement de l'épreuve orale
anticipée de français
revoyez le manuel, les synthèses sur vos quatre objets d'étude
Révisions dans le manuel |
||
| index des notions, pages 430, 431 ; | ||
le roman, pages 210, 211 ; le théâtre, pages 220, 221 ; la poésie, pages 232, 233 ; |
l'apologue, pages 262, 263 ; le conte, pages 270, 271 ; l'essai, pages 278, 279 ; le dialogue argumenté, pages 288, 289 ; démontrer, convaincre, persuader, délibérer, pages 298, 299 ; |
le commentaire, pages 387, 389 ; la dissertation, pages 403, 404, 405, l'écriture d'invention, pages 420, 421. |
| Présentez-vous, non seulement avec les textes, mais avec chacune des oeuvres complètes : Montserrat, Madame BOVARY, Les Fables, Les Fleurs du Mal. |
| Pour les questions d'écrit, en principe deux, répondez-y avant le devoir, elles sont censées vous-y préparer, certains éléments pourront donc être repris et développés dans le devoir. Conformez-vous à la forme fixée (une demi page à une page), n'oubliez pas de citer les textes (souvent au nombre de trois). Ne faites pas trop court, mais gardez des forces et de l'énergie pour le devoir qui est noté sur 14, alors que les questions ne sont notées que sur 6. Cependant ne passez pas trop vite sur les questions, soyez attentifs, souvent elles viennent compenser la note du devoir. |
| Pour le commentaire de texte à
l'écrit, vous pouvez utiliser le même schéma que pour
l'exposé oral, simplement, les deux axes vous serons
proposés, en même temps que la question, par le sujet. Lisez donc attentivement le sujet. Et relisez le plusieurs fois en cours de rédaction. |
| Pour l'écrit d'invention, rappelez-vous que le groupement de textes (corpus) est là en principe pour vous aider et pour vous guider. Respectez bien la forme proposée par le sujet : lettre personnelle, lettre à un journal, article de presse, autobiographie, journal intime, dialogue... |
| Pour la dissertation, appuyez vous sur les textes du corpus pour donner des exemples, vous pouvez aussi faire référence aux textes, auteurs et oeuvres étudiés en classe, et à vos lectures personnelles. Vous devez montrer que vous avez travaillé. |
| Utilisez pour le devoir écrit les quatre heures qui vous sont données. |
| Évitez des textes trop denses, aérez en passant une ligne après l'introduction, à la fin de la première partie, à la fin de la seconde, divisez chaque partie en plusieurs paragraphes. |
| Soignez l'écriture pour qu'elle soit facile à déchiffrer, distinguez le "a" du "o", le "n" du "u", mettez les points sur les 'i". Ne négligez pas les accents et les majuscules. Relisez votre copie. |
Étude du personnage de
roman : 
Le Théâtre MONTSERRAT |
Convaincre, Persuader,
Délibérer 
exercice portant sur les figures de style

ORAL
| Pour l'entretien, revoyez le
manuel, les synthèses sur vos quatre objets d'étude. Ayez présents à la mémoire la liste des objets d'étude les titres et les noms des auteurs des textes présentés. |
Fiche conseil pour l 'oral
du bac de Français 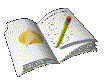
Objet d'Étude 1 :
Étude d'une
oeuvre romanesque : Madame Bovary 
1. Le roman et ses personnages :
visions de l’homme et du monde
À partir des questions que soulève l’étude des
personnages, il s’agira d’aborder le roman comme une forme littéraire privilégiée de
représentation de l’homme et du monde. En situant
une œuvre dans son contexte littéraire, historique et
culturel, on s’interrogera sur l’évolution
du genre romanesque.
En ce qui concerne Madame Bovary, notons
tout d'abord le sous-titre du roman : "Moeurs de province",
qui nous indique une étude à caractère sociologique. (en
cela, il s'inspire en partie de La Bruyère
Jean de La Bruyère (Paris, 16 août
1645 - Versailles, 10 mai 1696) est un moraliste
français.
La Bruyère est célèbre pour une œuvre unique, Les Caractères
ou Les mœeurs de ce siècle (1688). Cet
ouvrage, constitué d'un ensemble de brèves pièces
littéraires, compose une chronique essentielle de l'esprit du
XVIIe siècle.)
Le Provincial étant réputé plus bête que le Parisien. C'est,
bien entendu, une opinion de parisien. Les provinciaux ne se
privent d'ailleurs pas de traiter de "Parisiens" tous
les étrangers au pays un tant soit peu empotés ! Mais Flaubert
n'est pas parisien. C'est un provincial. Alors, que penser ? S'il
y a satire, il n'est pas interdit à l'auteur de s'inclure dans
la satire et l'on pourra ainsi employer le mot affreux, mais
précis d'autodérision. Voilà peut-être la raison de ce
"nous" persistant : on lit page 54 de l'édition Folio
"Il serait maintenant
impossible à aucun de nous de rien
se rappeler de lui." Le "maintenant" se référant
au présent de l'écriture, et notre narrateur racontant les
faits dont il dit ne pas pouvoir se souvenir !
"La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage", cette phrase qu'on aurait pu croire issue de la bouche d'un romantique sort en réalité de celle d'un philosophe, il est vrai très en avance sur son époque. Il s'agit de Denis DIDEROT. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas de la poésie, mais De la poésie dramatique, c'est le titre de son ouvrage, c'est à dire du théâtre. Il n'en reste pas moins qu'une telle pensée pouvait très bien faire office de slogan pour la littérature romantique.
Cependant, il convient de ne pas nous égarer, plus que le romantisme, c'est le romanesque qui emporte Emma dans le rêve d'une vie aventureuse. C'est ce désir inassouvi qui la jettera dans un ennui mortel.
Cependant si la quête de l'amour ou plutôt de l'amant rêvé occupe Emma tout au long du roman, c'est bien cependant l'argent qui la tuera, plus exactement les dettes et la machine judiciaire que Flaubert a dû affronter dès la publication de son roman, en 1857.
au passage, quelques définitions intéressantes -et compliquées- de la poésie : "Qu'est-ce que la poésie ?".
J'ai mes propres définitions : le roman, c'est la littérature de la solitude,
solitude de l'auteur, solitude du lecteur,
le théâtre, c'est une activité multiartistique de groupe,
groupe des acteurs, la "troupe", et la communion avec
le public. L'auteur s'efface derrière la mise en scène. La poésie, c'est l'intime de l'auteur qui
parle à l'intime du lecteur, c'est la
littérature de la différence et c'est pourquoi on trouve
des définitions si différentes de la poésie, regardez plutôt
voir ici ce que
Flaubert écrit à propos des Misérables,
de Victor Hugo et qui montre, ce qu'on savait déjà, que
l'auteur de Madame Bovary n'était pas à
proprement parler un homme charitable 
| Portrait de Catherine-Nicaise-Élisabeth LEROUX |
| - souligner les mots et
expressions qui font appel à la compassion
du lecteur -nous sommes alors dans le registre pathétique - l'expression "rigidité monacale" pourrait nous faire penser à une sorte de sainteté - comparer avec le portrait de la servante Félicité dans la nouvelle Un Coeur simple - nous sommes proches de l'écriture naturaliste de Maupassant, disciple de Flaubert décrivant les paysans cauchois. |
Emma au couvent  exposé et commentaire
exposé et commentaire 
Dernièrre explication complémentaire : Charles aux Bertaux chapitre 3
Commentaires à propos du devoir de fin de période sur Charles aux Bertaux :
à rappeler que tout devoir, écrit ou oral doit comporter vos remarques argumentées et des citations du texte à l'appui de celles-ci.
- tout d'abord un contresens grave à éviter : ligne 23 "il la regardait se traîner" ce que Charles regarde, c'est la poussière, et c'est la poussière qui se traîne, poussée par l'air qui passe sous la porte. Ainsi se trouve rappelée la timidité de Charles annoncée dès l'incipit du roman, et son caractère contemplatif, que l'on peut opposer au caractère actif et volontaire d'Emma.
- si vous
voulez approfondir les
valeurs des temps :
Le
passé simple :
"Il arriva, il entra, n'aperçut point, , alla, emplit, versa, porta,
rassit, reprit,
" => événement, appartient à la narration.
néanmoins, on peut observer pour proposa, refusa, insista, offrit qu'il s'agit là déléments du discours narrativisé, c'est-à-dire d'un dialogue entre Charles et Emma dont les paroles sont évoquées mais ne sont pas rapportées avec précision.
L'imparfait
:
"Tout le monde était aux champs" => exprime
une circonstance : tout le monde était aux
champs, c'est-à-dire surtout que le père était absent, Emma et
Charles vont se trouver en tête-à-tête. Nous rangerons donc
cet élément dans le cadre de la description.
"Les auvents étaient fermés" : même valeur,
nous sommes donc dans la pénombre, cette circonstance peut
favoriser l'intimité de cette rencontre entre Charles et Emma.
"Des mouches, sur la table, montaient le long des verres", ici il
s'agit d'une action,
considérée dans sa durée - ce n'est pas un événement : elles montaient
déjà avant l'arrivée de Charles (elles montaient, les unes et
les autres, les unes après les autres, sans cesse, l'action est imparfaite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée.) Même chose pour "descendait", "bleuissait", "cousait".
- en ce
qui concerne la prise
en charge
-toute relative- de
la description
par Charles, on pouvait relever les trois verbes de perception : "aperçut, regardait, entendait" et ajouter que le reste
du temps il peut sembler implicite que les éléments rapportés dans la
description sont observés par Charles (bien qu'on sente très
fort la "patte" de Flaubert dans cette observation.)
à noter également les autres détails observés dans la cuisine
: "Des mouches sur la table, montaient le long des verres
qui avaient servi, et bourdonnaient en se noyant au fond, dans le
cidre resté." Pour nous signaler ici l'hygiène une peu
contestable (peut-être une observation de médecin), le
laisser-aller marquant l'absence de la mère défunte, la notation sonore ("bourdonnaient")
déchiffrée comme le son d'une agonie un élément pathétique et tragique dans ce qui est une scène de bonheur et pourquoi pas une sorte de mauvais présage. Le cidre rappelant que nous sommes en Normandie.
le curaçao, lui, est une orange amère des Antilles, et une liqueur préparée à partir de son écorce en particulier en Hollande, d'où l'idée d'exotisme.
- pour ce
qui est de la sensualité, on peut observer qu'elle
s'exprime déjà par l'émotion esthétique dans l'observation du décor :
"veloutant
la suie de
la plaque", "bleuissait un peu les cendres froides".
Charles, dès son arrivée prend possession du décor, c'est sa
façon d'entamer la possession d'Emma : il se met en appétit de
contemplation.
Néanmoins l'essentiel de la sensualité n'est pas dans le regard
de Charles, il serait plutôt dans les attitudes et les gestes
d'Emma : ""elle se renversait pour boire ; et le tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir,
tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre." Il va
sans dire que Charles est ému par le spectacle et ces promesses
symboliques de sensualité
quasi animale
que lui donne ici Emma, des dispositions qui étonneront Léon
Dupuis dans sa petite chambre de Rouen à la fin du roman ("Elle avait des paroles tendres avec des baisers
qui lui emportaient l'âme. Où donc avait-elle appris cette corruption, presque immatérielle à force d'être
profonde et dissimulée?" fin du chapitre V de la troisième
partie).
Pour ce qui est du troisième paragraphe, on pourrait croire à une atmosphère de gêne ou d'indifférence entre Charles et Emma ""elle ne parlait pas. Charles non plus". Il n'en est rien, il semblerait plutôt que ce soit une scène d'apaisement, après l'énervement sensuel du paragraphe précédent, presque une scène de calme bonheur conjugal. Emma et Charles sont bien ensemble, ils n'ont pas besoin de se parler (le discours ne rapproche pas toujours, il maintient souvent une distance, celle des convenances).
Trois extraits :
- premier extrait : l'incipit "La casquette de Charles" celui-ci est présenté au lecteur à travers une scène de comédie. Charles fait figure d'antihéros, c'est le portraît d'un imbécile.
- second extrait : "Emma au couvent ", la vie est un roman, ou comment se forme le caractère romanesque d'Emma, à partir des lectures, des élans mystiques, des héroïnes de l'Histoire, les exemples du passé avec le regard tourné vers un avenir plein d'espoirs.
- troisième extrait : "La visite de Charles à la ferme des Bertaux", une vision réaliste et sensuelle de la vie, le goût du détail précis, de l'observation, le bonheur dans l'immédiat des sensations, un ancrage solide dans le présent, dans l'observation et dans la description, description de ce qui entoure le personnage, ici Charles, vu, observé, senti par celui-ci.
Remarque sur les noms des personnages : il semble que Flaubert se soit amusé Héloïse, Hivert conduit l'Hirondelle, Tuvache, Homais (Oh, ... mais...), Lheureux, Léon (le cri du paon), Boulanger l'aristocrate, Berthe et les Bertaux, maître Hareng, Charbovary (charivari)...
Le racisme de Lheureux :
" -Une misère, répondit-il, une, misère; mais rien ne presse; quand vous voudrez; nous ne sommes pas des juifs! "
" - Ah bien, oui! calmer Vinçart; vous ne le connaissez guère; il est plus féroce qu'un Arabe."
" - A qui la faute? dit Lheureux en la saluant ironiquement. Tandis que je suis, moi, à bûcher comme un nègre, vous vous repassez du bon temps."
Pourquoi Flaubert écrit-il ?
N'importe, bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire ! que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s'entre-fermer leurs paupières noyées d'amour. » A Louise Colet. 23 décembre 1853.
(On est ici bien au delà de l'hypothétique "Madame Bovary c'est moi")
- comparez avec cette définition du réalisme par Romain GARY cité par l'écrivain d'origine canadienne Nancy HUSTON comme épigraphe de son roman Une Adoration publié en 2003 :
Le réalisme est une illusion de réalité, le personnage est toujours l'auteur, l'objet est le personnage, il est l'auteur, cet arbre que je regarde et décris est touché par la culture, il est Jeanne d'Arc et la retraite de Moscou, nos ancêtres les Gaulois, la Joconde, il est mon oeil.
Rétrospective
Courbet au grand palais 
Champfleury, en 1857, dans un ouvrage intitulé Le Réalisme, définit en ces termes la théorie du mouvement: "La reproduction exacte, complète, sincère du milieu où l’on vit, parce qu’une telle direction d’études est justifiée par la raison, les besoins de l’intelligence et l’intérêt du public, et qu’elle est exempte de mensonges, de toute tricherie."
L’écrivain réaliste préfère donc le réel au romanesque, et en conséquence, l’objectivité à la subjectivité. La méthode adoptée aura donc un caractère scientifique, les faits seront établis et décrits à partir de l’observation et d’une documentation précise.
La littérature réaliste a réuni des noms prestigieux : Gustave Flaubert (malgré lui), son disciple Guy de Maupassant, les frères Edmond et Jules de Goncourt (1822-1896 et 1830-1870) et, dans une sorte d’apothéose qui a été nommée le naturalisme, Emile Zola.
Le réalisme : cité par Champfleury dans une lettre à George SAND :
M. Proudhon, dans la Philosophie du progrès (1853), jugeait sérieusement les Baigneuses : "L'image du vice comme de la vertu est aussi bien du domaine de la peinture que de la poésie : suivant la leçon que l'artiste veut donner, toute figure, belle ou laide, peut remplir le but de l'art."
Toute figure belle ou laide, peut remplir le but de l'art ! Et le philosophe continue : "Que le peuple, se reconnaissant à sa misère, apprenne à rougir de sa lâcheté et à détester ses tyrans ; que l'aristocratie, exposée dans sa grasse et obscène nudité, reçoive, sur chacun de ses muscles, la flagellation de son parasitisme, de son insolence et de sa corruption." Je passe quelques lignes et j'arrive à la conclusion : "Et que chaque génération, déposant ainsi sur la toile et le marbre le secret de son génie, arrive à la postérité sans autre blâme ni apologie que les œuvres de ses artistes."
"Ah! la vie, la vie! la sentir et la rendre dans sa réalité, l'aimer pour elle, y voir la seule beauté vraie, éternelle et changeante, ne pas avoir l'idée bête de l'anoblir en la châtrant, comprendre que les prétendues laideurs ne sont que des saillies de caractères et faire vivre, et faire des hommes, la seule façon d'être Dieu!"
Zola, L'Oeuvre 1886
Quel enfantillage, d'ailleurs, de croire à la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre odorat, notre goût différents créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre.
Maupassant, extrait de la préface de Pierre et Jean
Explorez l'article sur le "Nouveau réalisme" de wikipédia, en
particulier Marcel DUCHAMP et Rrose Sélavy, vous ne serez pas déçus
du voyage voir
aussi
Pour le
réalisme aux États-Unis, voir "The Jungle"

************************************
Début de roman : Madame Bovary
N'oubliez jamais de citer le texte à l'appui de vos affirmations.
Pour ce qui est de la situation d'énonciation, il faudra toujours être prudents dans ce roman. S'il semble évident que la scène est vue et racontée par un des élèves de la classe, il n'est pas exclu que Flaubert se soit situé à la place de celui-ci : cet élève là, c'est moi ! s'est-il peut-être dit au moment d'écrire.
D'autant plus qu'il n'est pas facile de voir le moment ou Flaubert reprend la main en tant que narrateur omniscient. A partir de l'instant où le roman évoque les parents de Charles, les élèves de la classe ne sont pas censés les connaître, cependant, on trouve par la suite un "nous" qui confirme que nous n'avons pas changé de narrateur, et qu'il s'agit toujours d'un des élèves de la classe..
registre comique
comique de situation : "il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux"
Ici, le comique réside dans l'indécision du personnage, dans son hésitation.(ce qui peut donner lieu à un comique de répétition si cette hésitation se prolonge et s'il envisage plusieurs fois les mêmes solutions, à un comique de geste s'il marque par des gestes ses hésitations).
comique de caractère : "resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine", cette image symbolise la situation d'angoisse du nouveau, mais elle préfigure également la timidité excessive de Charles, que l'on peut facilement tourner en ridicule, (" n'osant même croiser les cuisses" "ou qu'il n'eût osé s'y soumettre") , ainsi ce trait de faiblesse de son caractère se trouve sanctionné par le rire.
"soit qu'il n'ait pas remarqué cette manoeuvre", ici, c'est l'inattention de Charles qui est sanctionnée, peut-être même la bêtise qui est suggérée. (voir la description de la casquette : "comme le visage d'un imbécile"... telle casquette, tel élève !)
comique de geste : "Il se leva, sa casquette tomba, toute la classe se mit à rire", la chute, d'un objet, ou d'une personne est un des éléments fondamentaux du comique de geste, le rire est provoqué par la surprise, du specateur ou de l'acteur, ici le spectateur a pu prévoir et rit de la sottise et de l'imprévoyance de l'acteur (ici Charles).
"Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore une fois", ici la répétition de la chute et du geste de Charles tournent au gag, l'action du héros devient geste mécanique, d'où une dépréciation de l'être humain et un effet comique.
Pour approfondir votre analyse du rire, je vous conseille la lecture du petit livre de Bergson intitulé précisément : Le Rire
La nature du comique : Henri
BERGSON, LE
RIRE (1900) document word à télécharger

Théâtre et argumentation directe (entre les personnages): la scène d'exposition, texte et représentation, le dialogue argumenté, espace scénique et espace dramatique, rôle du récit au théâtre, la mise en scène. l'Essai (argumentation directe).
Un argument ad hominem est un argument qui porte sur la personne même de l'adversaire plutôt que sur ses idées ou positions politiques. Une recherche antérieure propose de répartir les arguments ad hominem en trois principaux types : logique (une mise une contradiction entre deux positions), circonstanciel (une mise en contradiction entre une position et une action) et personnel (une attaque directe).
Un petit exposé sur
Salcedo. L'introduction et la lecture sont correctes, le
commentaire est à enrichir. Construisez sur deux axes et creusez
le texte. 
Commentaire de l'exposé 
Convaincre, Persuader, Délibérer :
- argumentation directe : l'Essai
Texte Jacques COPEAU  exposé et commentaire
exposé et commentaire 
- argumentation indirecte : le Conte philosophique
Texte Voltaire "Candide"
Les Abares et les Bulgares
- argumentation indirecte : le Conte de Fées
- argumentation indirecte : La Fable
toujours excellent travail de
DANIELLE GIRARD - Lycée Jeanne d'Arc de ROUEN, sur les Fables de
Jean de La Fontaine 
La Cigale et la Fourmi  voir aussi :
voir aussi : 
Un exposé - pas parfait-
mais qui approche les 10 minutes, La Jeune
Veuve 
et le commentaire 
exposé Le
Vieillard et les trois jeunes hommes  et le commentaire
et le commentaire 
****************************************************************************
LA POÉSIE :
Baudelaire : Le Spleen de Paris (Petits Poèmes en Prose)
Une explication,
peut-être un peu complexe, des Fenêtres, qui peut compléter le
cours. 
Baudelaire Les Fleurs du Mal
cours : A
une Passante :
question : Sur
quelles oppositions ce poème est-il construit ? 
Voir le
poème d'Antoine POL chanté par Georges BRASSENS Les Passantes

Mardi 6
mai : nous avons vu "Réversibilité" 
RÉVERSIBILITÉ,
subst. fém.
Qualité de ce qui est réversible.
A. [Corresp. à réversible A]
1. DROIT
a) Qualité de ce qui peut ou doit revenir à son
propriétaire. Réversibilité d'un bien, d'une terre.
Réversibilité des apanages, des fiefs (Ac. 1878-1935).
b) ,,Caractère attribué à une pension de retraite, à
une rente viagère ou à un usufruit et en vertu duquel la rente
ou l'usufruit devront intégralement profiter soit au survivant
des bénéficiaires, soit à une personne autre que le
bénéficiaire sans subir de diminution au décès du
prédécédé`` (CAP. 1936). Réversibilité
d'une rente, d'une pension, d'un usufruit.
2. THÉOL. CATH. Réversibilité (des mérites). Conséquence
du dogme de la communion des
saints en vertu de laquelle les mérites obtenus par les saints,
les bonnes œeuvres ou les souffrances des justes profitent
à l'ensemble de la communauté de l'Église.
Offrir sa souffrance, offrir son agonie, avec la conviction
d'une réversibilité de son holocauste sur ceux qu'il aime (BOURGET, Sens mort, 1915, p. 322). C'est
[Le Soulier de Satin] l'univers de l'intercession, de la
réversibilité parce que c'est l'univers de la chute et de la
grâce (MAURIAC, Nouv. Bloc-Notes,
1961, p. 196).
question : "Expliquez le titre". axe 1 Le Bonheur, axe 2 Le Malheur. Dans l'axe 1, la Bonté qu'il faudrait définir : savoir donner, aimer, pardonner... ouverture vers les autres, envie de partager son bonheur, d'atténuer le malheur des autres, elle donne une bonne image de soi à soi et aux autres et donc peut rendre heureux soi-même et les autres.
à propos de l'expression "Ange de lumière", notons ceci :
Dans la Bible, nous
apprenons que Satan était à l’origine un ange appelé Lucifer qui signifie « Ange de lumière » Le mot « ange » signifie « messager ».
Ce qui donne pour Lucifer « Messager de lumière »
Voilà
donc un élément d'explication du titre "Réversibilité"
: derrière l'expression "Ange de lumière" se cache
Satan, derrière une expression qui semble signifier le Bien, se
cache le Mal. Nous
sommes dans le paradoxe du titre du recueil : Les
Fleurs du Mal.
****************************************************
Le Coffret de santal
 de
Charles CROS
de
Charles CROS
Charles CROS "Ballade
du dernier amour" 
présentation de la question : "La poésie est souvent l'expression de la joie ou de la tristesse du poète. Il nous est demandé de dégager l'aspect élégiaque de cette ballade. Nous procéderons en deux temps. Premièrement nous analyserons le bilan de vie que nous présente le poète puis nous verrons comment il en fait le prétexte à un nouveau départ.
J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans
